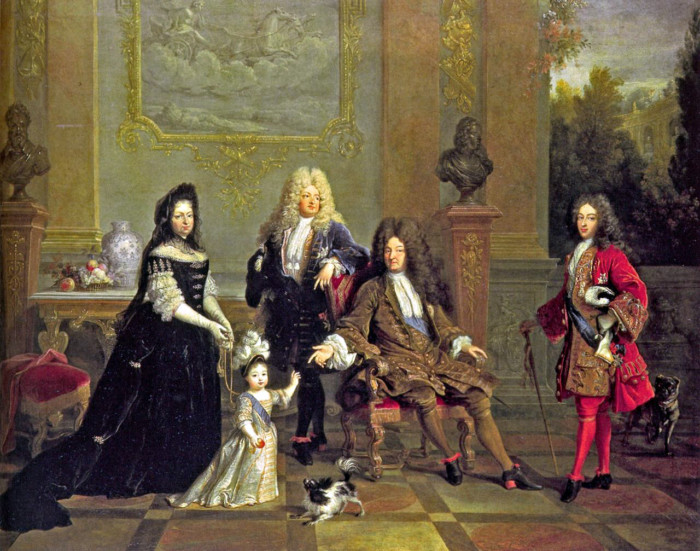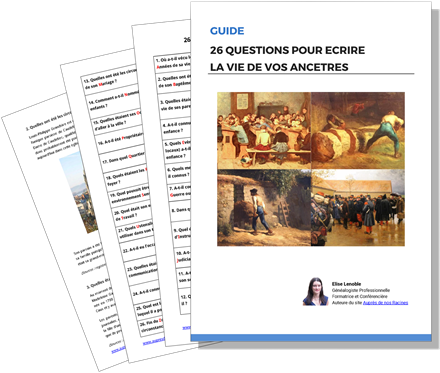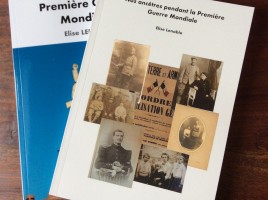Racontez l’histoire de vos ancêtres Invisibles
Après avoir remonté une grande partie de ma généalogie, j’ai voulu écrire l’histoire de mes ancêtres pour pouvoir la partager avec ma famille.
En faisant cela, je me suis rendue compte que je trouvais facilement des choses à dire sur certains ancêtres. En particulier ceux qui avaient eu une vie un peu compliquée et que j’avais passé du temps à retracer.
Par exemple : un arrière grand père qui avait été officier militaire, un autre arrière grand père dont j’avais retrouvé le dossier d’enfant assisté, ou encore une ancêtre qui avait eu 8 enfants nés de père(s) inconnu(s) et que j’avais passé du temps à rechercher, et bien d’autres encore.
Mais, autour d’eux, il restait tous les autres ancêtres sur lesquels je ne savais pas trop quoi dire. Tous avaient eu une vie très simple : souvent ils étaient nés, s’étaient mariés et étaient décédés dans le même petit village, et ils n’avaient pas eu de profession extraordinaire.
A vrai dire, pour la plupart, je n’avais pas fait beaucoup de recherches à leur sujet, en dehors de l’état civil.
Tous ces ancêtres, je les ai nommés les Invisibles, parce que ce sont des ancêtres que l’on oublie, au moment de faire nos recherches généalogiques et encore plus au moment de raconter notre histoire familiale.
Remarque Pour écrire simplement l'histoire d'un ancêtre, le mieux est de commencer par télécharger le guide 26 questions pour raconter la vie d’un ancêtre en cliquant ici.
Vous aussi, vous avez sûrement déjà ressenti cela. Vous avez certainement des ancêtres ou des branches « phares » sur lesquels vous avez focalisé une grande partie de vos recherches, et d’autres ancêtres pour lesquels vous avez simplement cherché les dates de naissance, mariage et décès, avant de passer à autre chose.
Car des ancêtres Invisibles nous en avons tous dans nos arbres généalogiques. Et parfois ils constituent même la plus grande partie de nos ancêtres. Et au moment d’écrire notre histoire familiale, nous ne pouvons pas faire l’impasse sur un pan entier de notre généalogie au prétexte qu’ils ne se sont jamais fait remarquer.
Mais par rapport à d’autres ancêtres qui ont eu un destin extraordinaire, nous pouvons avoir l’impression que l’on ne pourra pas raconter leur vie, voire même que leur vie ne mérite pas d’être racontée et qu’ils n’ont pas d’histoire.
Pourtant leur vie a compté tout autant que celle de nos autres ancêtres, et même si leur histoire est ordinaire, elle mérite d’être racontée, parce qu’elle est le reflet de l’histoire de leurs contemporains.
En fait, c’est un peu comme en peinture. Beaucoup de peintures anciennes représentent des choses grandioses : des personnages importants, des scènes bibliques ou mythologiques, ou encore des scènes de guerres.
Mais, peu de peintres s’intéressaient à la vie quotidienne des gens à la campagne.
Pourtant, ces peintures naturalistes qui représentent la vie dans les champs ou dans les petits villages, nous permettent de beaucoup mieux nous représenter la vie de nos ancêtres qu’une peinture de Louis XIV.
C’est pour cette raison qu’il est important de s’intéresser à la vie de nos ancêtres Invisibles parce qu’ils représentent la « vraie » vie de nos ancêtres.
Après avoir fait ce constat, j’ai donc décidé de me pencher particulièrement sur la vie de mes ancêtres Invisibles pour raconter leur vie.
J’avais donc publié un article sur mon blog, dans lequel j’avais choisi 3 ancêtres invisibles, parmi beaucoup d’autres, dont je souhaitais raconter la vie.
J’avais choisi de commencer par Jean Cantat, un métayer de l’Allier au 19e siècle, sur lequel je ne savais quasiment rien. De ce fait, au moment de commencer, je ne savais vraiment pas ce que j’allais pouvoir écrire à son sujet.
Au final, j’ai fait beaucoup de découvertes sur sa vie, que ce soit par des documents le concernant personnellement ou en étudiant son environnement de vie.
Et cela a été une expérience passionnante qui m’a permis de beaucoup mieux connaître les conditions de vie des métayers dans l’Allier.
Cela m’a donc aidée à comprendre la vie de cet ancêtre, mais aussi de tous les autres ancêtres qui vivaient à la même époque au même endroit.
(L’article ce que j’ai pu écrire sur mon ancêtre Jean Cantat est ici).
Grâce à cette expérience, je me suis donc rendue compte que l’on pouvait écrire la vie de tous nos ancêtres, même les Invisibles.
Depuis, j’ai refait la même chose avec plusieurs de mes ancêtres (par exemple, pour la biographie de mon ancêtre Sophie Martin).
En me penchant sur la vie de ces hommes et de ces femmes, j’ai pu vraiment mieux comprendre leurs conditions de vie. Cela m’a également permis de faire des découvertes auxquelles je ne m’attendais pas.
Par exemple, j’ai découvert qu’un ancêtre qui semblait n’avoir jamais quitté son village natal avait en fait participé à la conquête de l’Algérie pendant son service militaire.
Vous aussi, vous pouvez raconter la vie de vos ancêtres Invisibles. Regardez votre arbre, et choisissez dedans un ancêtre au hasard. Un ancêtre sur lequel vous avez l’impression de ne rien savoir.
Et il n’est même pas nécessaire de remonter très loin pour cela : choisissez un ancêtre au 19e siècle, puis essayez de raconter sa vie. Notez tout ce que vous savez à son sujet même les plus petits détails.
Il n’y aura peut-être pas beaucoup à raconter, du moins au début, mais ce qui compte c’est de se lancer. Et vous verrez qu’au final on découvre toujours beaucoup plus de choses qu’on ne l’imagine.
Voilà, c’était ce que je voulais partager avec vous aujourd’hui : parlez de vos ancêtres invisibles !
Remarque Pour écrire simplement l'histoire d'un ancêtre, le mieux est de commencer par télécharger le guide 26 questions pour raconter la vie d’un ancêtre en cliquant ici.
Pour retrouver toutes mes vidéos de généalogie, cliquez ici.
Elise